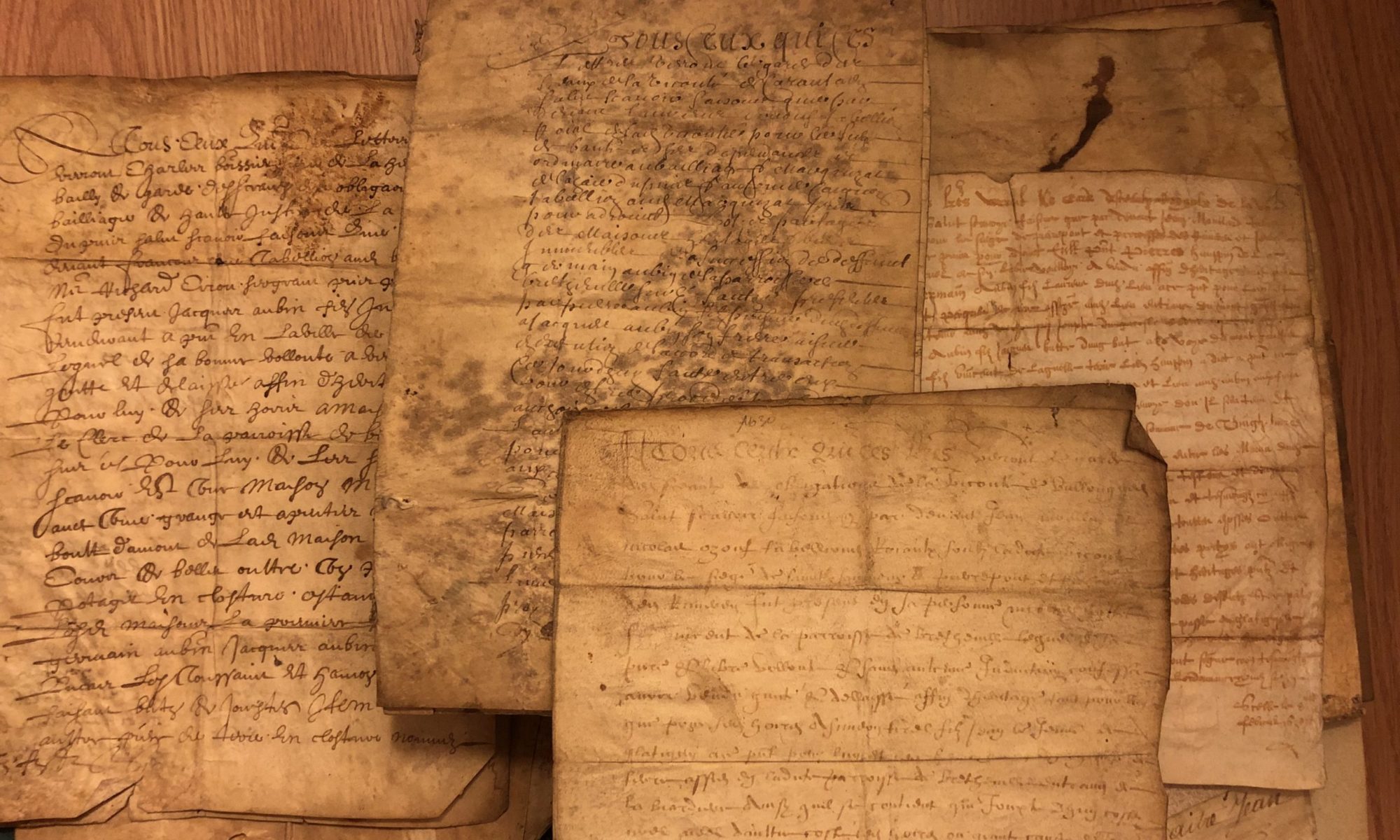Découvert par Christophe CANIVET, un article sur Marie RAVENEL par Charles CANIVET (alias Jean de Nivelle)
Le Soleil, 28 août 1881 p. 1 et 2
https://www.retronews.fr/journal/le-soleil/28-aug-1881/661/1625669/1
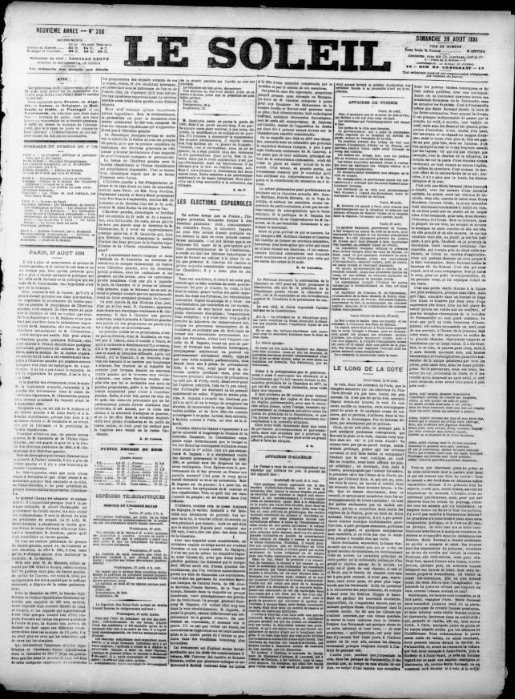
LE LONG DE LA CÔTE
Saint-Vaast, le 27 août [1881].
Je vois, dans les journaux de Paris, que la tempête annoncée par les dépêches du New-York Herald n’a pas tenu toutes ses promesses. Ce n’est pas ici qu’on s’en aperçoit. Depuis trente-six heures, le vent du sud-ouest souffle en tempête, avec accompagnement de pluie et de quelques coups de tonnerre, qui se perdent, d’ailleurs, dans la violence de la bourrasque. Pas de bateaux dehors, par conséquent pas de poisson.
Donc, on ne sort plus, ou presque pas ; à part quelques personnes courageuses, qui bravent la pluie et le vent, chacun reste confiné chez soi. Ah ! le joli mois d’août ! Ne croyez-vous pas qu’un pareil temps, indéfiniment prolongé, puisse agir sur certains cerveaux et leur faire battre la campagne? Pendant que le vent continue de souffler en tempête, nous nous offrons un plaisir artistique, en écoutant, d’un bout à l’autre, accompagnés par l’auteur lui-même, la première série des Chants de la Patrie, publiée par l’éditeur Grus, et qui ont eu, comme vous le savez, un succès si mérité, dans les concerts des deux derniers hivers, à Paris. Que de choses charmantes, dans ce recueil, et savamment encadrées dans les accompagnements de Louis Lacombe ! Ce sont des perles enchâssées par un maître sertisseur, qui les a recueillies dans toutes les régions de la France, pour en faire un bijou national. Dans ce pays-ci, il n’y a pas grand’ chose comme musique traditionnelle, peut-être rien. À part quelques chansons, grivoises pour la plupart, et quelques complaintes sans caractère, je ne crois pas que le musicien puisse y recueillir rien qui vaille.
Chose étonnante, cependant, la basse Normandie qui ne compte pas, que je sache, un grand nombre de musiciens, est extrêmement riche en poètes. Le caractère principal de cette poésie est la mélancolie mélangée d’un grand et sincère amour de la nature. Le pays est si plein de vrai charme, si vert et si fleuri, que le besoin de chanter tout cela est à peu près naturel. Il n’est pas, cependant, dans notre pays, de gens plus vagabonds que les Normands. Jadis, ils partaient à la découverte des pays lointains, de compte à demi avec les Bretons. Dieppe et Saint-Malo en gardent des souvenirs séculaires. Aujourd’hui, ils s’expatrient encore, tout en laissant quelque chose d’eux-mêmes dans la contrée natale. On dit que les Chinois qui s’exilent assurent, par une clause spéciale, le retour de leurs cadavres dans le Céleste Empire. Les Normands ont quelque chose de ce culte national, et tous ceux, — ils sont nombreux, — qui s’expatrient, ont pour idée fixe d’y revenir finir leurs jours, à l’endroit même où ils sont nés, comme les oiseaux reviennent presque toujours mourir à l’endroit du premier nid.
L’autre jour, pendant que j’arpentais la côte, dans les parages de Fermanville, il me souvint que, au temps de mes études de collège, on parlait d’une femme, une meunière dont les poésies étaient remarquées et furent même publiées, avec une correspondance où se trouvaient quelques lettres des notabilités littéraires de la Normandie, sans en excepter les Facultés. C’est à Fermanville même que Marie Ravenel chanta la terre et les fleurs normandes. Pour gagner le rivage, il est presque indispensable de passer par le moulin. Le voilà, à mi-côte, tout habillé de neuf, mais sans les fleurs et les plantes grimpantes d’autrefois. L’eau tombe d’en haut, sur les roues, et se répand en nappes d’écume ; mais la muse n’est plus là. Elle est partie un peu plus loin, dans un hameau d’où l’on aperçoit la mer et le cap toujours assailli par les vagues. Ce qui n’a pas changé, par exemple, c’est le charme de la situation. Le moulin est sur la pente d’un énorme cirque verdoyant, au fond duquel se trouve l’église, au milieu du cimetière. C’est comme le dernier effort de la nature fertile de ce sol ; derrière, il n’y a plus que la lande, les falaises abruptes et la mer.
C’est cela que Marie Ravenel (Mme Lecorps) a chanté, avec des accents d’une sincérité parfaite. La poésie avait fait élection de domicile chez elle, comme le calcul chez Henry Mondeux. Comme Ovide, la jeune meunière était fatalement condamnée à écrire en vers. Je ne dirai point que sa poésie ait de larges ailes. Il lui manquait, pour cela, deux choses : l’éducation et l’étude. Mais on retrouve, dans la plupart de ses vers, les accents et comme la musique de cette contrée où elle est née, où elle grandit et où elle mourra. Je me fais conduire chez elle, ou plutôt, je me fais indiquer, à peu près, l’endroit où je pourrais la rencontrer. Cette immense commune, Fermanville, qui compte près de deux mille habitants, se divise en nombre d’agglomérations qui portent chacune un nom propre à la faire reconnaître. Marie Ravenel habite le hameau dit du Renouf. C’est elle qui nous reçoit, moi et mon compagnon dont je tairai le nom, pour ne point le compromettre, et, du premier coup, je lui explique l’objet de ma visite.
C’est une petite vieille femme à la figure des plus avenantes, presque sans rides, malgré l’âge, encadrée dans un bonnet de linge très blanc et éclairée par deux yeux d’une expression très douce. Cela lui fait plaisir de savoir qu’elle est visitée par un confrère, et que les strophes charmantes de la meunière de Fermanville ne sont point oubliées. Ce n’est pas qu’il en reste beaucoup d’exemplaires; elle-même en possède un seul, orné de son portrait, à l’heure de la jeunesse déjà murissante, la tête expressive et coiffée de la picarde blanche, légèrement empesée et maintenue par un large ruban. Il a été feuilleté, lu et relu, le pauvre petit livre, écrit il y aura bientôt quarante ans, aux heures amoureuses et contemplatives, quand les harmonies de la nature pénètrent par tous les pores, pour ainsi dire, dans les âmes privilégiées. En le parcourant, sous ses yeux, les souvenirs me reviennent en foule, et il me semble qu’en songeant au pays natal, et aux jours disparus, nous avons tous pensé à peu près ceci :
Adieu, petit moulin, demeure hospitalière !
Charmante solitude où s’ouvrit ma paupière,
Adieu, je vais quitter cet asile de paix !
Un destin ennemi m’arrache à ma patrie ;
Mais les doux souvenirs dont mon âme est remplie
Dans un autre séjour me suivront à jamais.
Adieu, théâtre heureux des jeux de mon jeune âge,
Arbres qui si souvent me prêtiez votre ombrage,
Écho, qui modulais mes joyeuses chansons,
Beaux prés, verte colline, étang, ruisseau limpide
Qui vîtes s’envoler mon enfance rapide,
Guérets où se jouaient de si riches moissons.
Adieu, petits oiseaux dont la fraîche musique
Soutenait si gaîment mon essor poétique,
Et que je nourrissais, durant les jours mauvais
Fleurs qui trouviez l’abri sous ma main tutélaire
Feuillages qui formiez mon autel solitaire,
Adieu ! d’autres peut-être y prieront désormais.
N’est-ce pas charmant, plein de grâce et de cette mélancolie dont je parlais plus haut et qui est comme une fleur du terroir ! Tout le recueil a été écrit dans ce délicieux vallon aujourd’hui délaissé. Il en présente tous les aspects, tantôt gais, tantôt tristes, suivant les impressions du moment. L’horizon n’est assurément pas immense, mais, pour qui sait observer tous les détails du paysage, entendre tous les accents qui s’y confondent, en respirer toutes les fleurs et tous les parfume, n’y a-t-il pas matière à impressions infinies ? Le grandiose n’a point trouvé place dans cette imagination poétique, et le livre ne dit rien, ou presque, de cette mer qui se brise constamment avec fracas, à quelques centaines de mètres et s’engouffre dans les déchirures des falaises. Marie Ravenel a chanté seulement ce qu’elle a compris et aimé. Ses stances sont des impressions de jeunesse, versifiées au tic-tac du moulin qui battait la mesure. Pourtant, elle écrit encore, mais pour elle. Peut être, quand l’heure sera venue, trouvera-t-on, quelque part, un nouveau recueil composé aux heures de loisir, dans cette demeure propre et accueillante, où vieillit la muse bas-normande. Elle ne s’en défend point, du reste. Est-ce que l’imagination vagabonde du poète ne revient pas toujours au vers, comme l’oiseau revient au nid ?
Maintenant, les heures sont comptées, et il faut partir, regagner Paris. Marie Ravenel nous reconduit jusqu’au seuil de sa porte, avec promesse de revenir l’année prochaine, et nous saluons cette vieille femme accorte et charmante, heureuse dans sa médiocrité ; qui, poussée et vantée, eût eu, sans aucun doute, à Paris, quelques jours de gloire et de renom bientôt soldés par les déboires et l’indifférence. Nous redescendons la pente assez raide du vallon, au soleil couchant, nous passons encore devant le moulin de Fermanville, et, avant de retrouver la voiture qui doit nous ramener à Saint-Pierre, puis à Barfleur et à Saint-Vaast, je jette un dernier regard sur ce pays aux aspects multiples et charmants, où, comme Marie Ravenel, on ne penserait qu’à écouter et à voir, si la politique, méchante et hargneuse, ne montrait, de temps en temps, sa grimace, derrière les haies et au détour des chemins, pour en cacher momentanément la fraîcheur, la verdure et les fleurs.
Jean de Nivelle